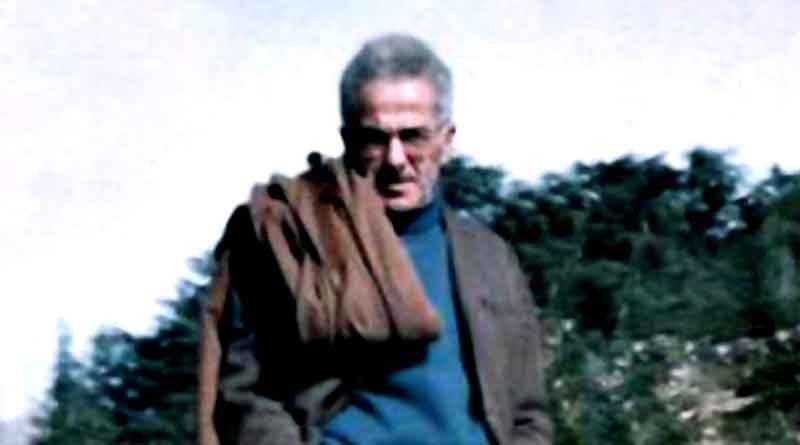On peut avancer l’idée qu’une véritable « révolution symbolique », opérée avec les anciennes catégories ancrées dans la tradition orale, est survenue avec Mouloud Mammeri suite à l’apparition des Poèmes kabyles anciens (1980). Ces textes kabyles, traduits en français, ont provoqué un renversement de situation en suscitant une prise de conscience de l’importance de l’écriture. Ils ont imposé de nouvelles structures cognitives et sociales, ainsi que de nouvelles catégories de perception et d’appréciation (Bourdieu, L’effet Manet, 2013).
L’observation spontanée des conditions apparentes de production des œuvres de M. Mammeri montre que les Poèmes kabyles anciens, publiés en France chez Maspero en 1980, s’inscrivent dans une série d’ouvrages du même ordre. Parmi eux, on peut citer Les Isefra de Si Mohand ou M’hand, paru en 1969, L‘Ahellil du Gourara en 1984, des ouvrages représentant souvent des poèmes berbères traduits en français. L’auteur de ces textes est également celui des romans en langue française, tels que La Colline oubliée (1952), Le Sommeil du juste, L’Opium et le Bâton (1965) et La Traversée (1982).
Ainsi, lorsque l’on réalise une analyse statistique rapide des ouvrages publiés par Mammeri, on constate qu’il a produit des œuvres diverses par la diversité des genres, tels que le roman, la nouvelle, le théâtre, la poésie, etc. Certains pourraient voir dans cette variété des genres une dispersion de son talent, immense et accompli dans le genre romanesque qui lui a valu sa renommée. Cependant, cette polyvalence, cette diversification de son expression, correspond à des états du champ (ou des champs), comme autant de possibilités : c’est un « capital de ressources ».
Sans vouloir ériger systématiquement les œuvres de M. Mammeri en chef-d’œuvre en les soumettant aux perceptions immédiates du sens commun, il est important de noter que ce recueil de textes n’est pas une œuvre ordinaire de « vulgarisation », c’est-à-dire une simple séquence linguistique qui ne sert qu’à communiquer des poèmes (kabyles) ; il dépasse largement la communication ordinaire et constitue une valeur symbolique importante. (Bourdieu, 2012, p. 277)
La dimension symbolique est d’abord portée par l’œuvre elle-même, par le choix du genre, mais aussi par la forme et le contenu. Sa force symbolique réside dans ces éléments constitutifs, mais également dans celui de son créateur, Mouloud Mammeri.
Comme on le sait, la publication de ce recueil de poèmes en 1980 survient après de nombreuses autres publications de romans importants en langue française et de réflexions linguistiques en berbère. Cependant, il ne faut pas perdre de vue un texte d’une importance capitale, La mort absurde des aztèques (1973), qui s’inscrit dans la même logique de production que les Poèmes kabyles anciens. Publié en 1973, quelques années seulement avant les Poèmes, ce texte peut être considéré comme un manifeste.
Cette œuvre désigne, dans ces conditions, un « signe intentionnel » répondant à une pulsion expressive (cette expression est de Bourdieu) qui prend ses racines dans un passé lointain. Mammeri le dit explicitement dans les entretiens accordés à Tahar Djaout :
[…] chacune de ces œuvres a correspondu à une réelle sollicitation, quelque chose comme une réponse à un appel.
Entretiens réalisés avec Tahar Djaout, 1987, p. 24.
J’ai conscience d’œuvrer dans une période de transition, où certaines possibilités (ou peut-être certaines audaces) me font défaut. Mais j’ai espoir de préparer le lit à des desseins plus radicaux et qu’un jour la culture de mes pères vole d’elle-même. (Mammeri, 1980, 2001, 2009, p. 15)
Cet intérêt expressif (Bourdieu) est nourri, depuis son enfance, par des sources diverses. Elles proviennent, d’une part, de toute la tradition familiale, à commencer par la transmission de la poésie kabyle par son père. Mouloud Mammeri, comme son père, se situe dans « la lignée de la tamusni ». Il vient d’une famille d’artisans (armuriers de père en fils depuis des siècles) – et non de paysans, comme dans beaucoup de tribus kabyles ; la différence est ici essentielle. De par leur fonction, les artisans étaient en contact permanent avec le monde extérieur, que ce soit en se déplaçant vers les autres villages alentour ou en accueillant des visiteurs venus parler, se rencontrer, échanger des proverbes et des paraboles, tout ce que l’on pourrait regrouper sous le terme de tamusni.
Contrairement au paysan dont le cercle d’échange et de la transmission était retreint, l’artisan avait un statut particulier (Dialogue avec Bourdieu). Dans ce sens, les expériences ultérieures de Mammeri, comme celles de l’école de son village ou encore son voyage au Maroc, sont structurées de la même manière. On le sait aujourd’hui, grâce aux travaux de P. Bourdieu, notamment son concept d’habitus, que les expériences ultérieures sont structurantes, d’autant plus qu’elles structurent même les nouvelles expériences (Bourdieu, 2012, p. 80).
Cet intérêt expressif est également nourri par les contraintes du champ d’expression, qui ont exercé sur Mammeri, à cette époque, une forme de censure. Il est important de comprendre que cette censure correspond à l’officiel, elle provient de l’officiel, c’est-à-dire de l’Etat et de tout ce qui le représente (Bourdieu, Langage, 2001, p. 343-377).
D’une manière générale, le degré du « dicible » correspond au poids de la censure exercée et à la force de l’intérêt expressif. Dans certains cas, cela peut ainsi correspondre au silence, la limite du discours censuré.
Le point de vue singulier de Mammeri, qui correspond à une position également singulière dans le champ expressif (15), découle de là. Ce point de vue n’est donc pas unique dans le champ, et sa particularité est qu’il ne correspond pas à celui soutenu par l’Etat, l’ « officiel » au sens bourdieusien du terme.
Comme il le dit dans le Dialogue sur la poésie orale en Kabylie avec Pierre Bourdieu :
Mon grand-père a passé délibérément tout ce qu’il savait de tamusni à mon père ; c’était conscient, parce que c’était lui qui la détenait dans sa génération. Il y avait là une espèce d’héritage qui est arrivé à mon grand-père qui l’a passé à mon père et mon père à un marabout de notre village.
Mammeri Mouloud, Bourdieu Pierre. Dialogue sur la poésie orale en Kabylie [1].
Mammeri, c’est celui qui a vu mourir le dernier sage du village, l’amusnaw comme il l’appelle, du nom de Sidi Louenas, celui qui voyait dans la mort du poète la disparition d’une tamusni. Tous ces éléments correspondent à ce que l’on peut désigner par l’habitus, ce qui oriente notre action, à partir de ce que l’histoire a déposé en nous.
Dans les conditions générales dans lesquelles elle a été produite, on peut considérer l’œuvre de Mammeri comme une opération de renversement d’une hiérarchie, d’une censure à la limite de la violence meurtrière. C’est une révolution symbolique qui a permis l’existence d’un autre régime.
[1] . Mammeri Mouloud, Bourdieu Pierre. Dialogue sur la poésie orale en Kabylie. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 23, septembre 1978. Sur l’art et la littérature. pp. 51-66; http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1978_num_23_1_2608